James Whale, U.S.A, 1931, 70 min
S’il est possible de dater la naissance du cinéma d’Horreur hollywoodien avec le « Dracula » de Tod Browning, c’est peut-être davantage la production Universal qui a suivi qui incarne encore le mieux cette idée. Adaptation d’une pièce de théâtre adaptée elle-même du roman de Mary Shelley publié en 1818, le « Frankenstein » de James Whale, qui prend lui aussi son inspiration dans l’expressionnisme allemand des années 1920, marque durablement Hollywood. Dans son exécution, comme dans ses prises de risques, qui à l’époque lui ont donné une étiquette sulfureuse, ce film a frappé les esprits au point de devenir une pierre angulaire de la pop culture.

On peut faire plus macabre?
Sorti la même année que « Dracula », dans une tentative claire de profiter du succès de ce dernier (d’ailleurs, au départ Bela Lugosi était prévu dans le rôle du monstre), il surpasse clairement les intentions du métrage de Browning. « Frankenstein » reprend la nature visuelle unique des productions Universal de l’époque, par une approche gothique qui mêle prise de vue extérieure et utilisation de décors en studio. Ce mélange savamment dosé donne à l’ensemble une dimension fantastique hors du temps. Mais c’est dans une approche plus pertinente de l’horreur que le film se démarque.
L’exploitation des pauvres, jusqu’à la tombe !
En 1931, les États-Unis traversent une période d’instabilité sans précédent depuis la Guerre de Sécession. La Crise de 1929 a engendré la Grande Dépression, qui voit le système capitaliste ébranlé et la population subir de plein fouet une forte récession. Autant dire que le moment s’avère peu propice à la gaudriole. Cela explique en partie comment les films d’Horreur de la Universal ont rencontré le succès. En mettant en avant des antihéros violents et amoraux, ils étaient raccord avec une population de plus en plus énervée contre l’ordre établi. Pour exemple, Dracula représente la décadence de la bourgeoisie, quand Frankenstein incarne les dérives d’un pouvoir déconnecté.

Henry Frankenstein (Victor dans le livre) est un scientifique issu d’un milieu noble, qui vit dans un château, et qui a tellement les moyens, que sa lubie est de déterrer des pauvres, pour créer de toute pièce un être humain. Sans pousser à l’allégorie forcée, il suffit de prendre en compte le contexte de l’époque. Il permet un parallèle avec ce riche qui exploite jusqu’aux cadavres des prolos, ne les laissant même pas la paix dans la mort. Cependant, il ne faut pas oublier qu’en 1931, ce n’est encore que du Cinéma, et il est facile d’interpréter un peu comme on veut. Maintenant, au regard du contexte dans lequel a été diffusé le film, il est amusant de déceler les coïncidences…
« Maintenant, je sais ce que ça fait que d’êtres Dieu !! »
« Frankenstein » est sorti dans une période de transition pour Hollywood, juste après l’arrivée du parlant et juste avant l’élaboration d’un système de censure élaboré. Cette période, surnommée « Pré code » (oui, simple, efficace), fut un moment riche en expérimentation, et surtout un moyen de briser des tabous. Si aujourd’hui le film de James Whale peut sembler inoffensif, à l’époque il avait déchaîné plus de scandale que toute la saga « Saw » réunit. La raison concerne deux séquences, pourtant furtives, mais auxquelles la bien-pensance puritaine de 1931 n’a pas trop goûté.
Tout d’abord, lorsque le Dr Frankenstein donne vie à son monstre, il déclare qu’il sait ce que ça fait que d’êtres Dieu, et qu’en fin de compte, il est un peu Dieu lui-même. Avant les années 1980, cette séquence était censurée, puisque ses paroles étaient couvertes par l’orage. Se prendre pour Dieu, et désacraliser ainsi le divin était une démarche blasphématoire sans précédent. Alors, bien entendu ce genre de propos se retrouvait déjà dans la littérature. Mais dans un médium comme le cinéma, avec une portée plus populaire, capable de toucher les masses, pour les Étatsuniens les plus radicaux, c’en était trop.

Ensuite, une séquence qui commence de manière poétique se termine par le Monstre de Frankenstein noyant une petite fille en la jetant dans l’eau. Ce passage, retrouvé dans les années 1980, montrant un enfant se faire tuer à l’écran, même si les raisons se justifient artistiquement (cette scène à un impact en amont dans le récit), c’en était trop. Laisser creuser des gosses au quotidien, dans une misère sociale extrême, était en 1931 une chose tout à fait courante. Par contre, montrer un monstre de fiction, jeter un mannequin dans la flotte, afin d’appuyer un propos dramatique dans une œuvre d’art, là ça ne passait pas.

L’hypocrisie autour du scandale concernant ces deux séquences met en lumière la mentalité forgée par la caste aisée au pouvoir, qui préfère vivre dans le déni. En revanche, le succès incroyable du film (pour l’époque et dans un contexte où aller au cinéma était coûteux pour les classes populaires) démontre que le public était enclin à accepter un potentiel message se cachant derrière cette histoire de savant fou. Si tant est qu’il y ait un message ciment pensé, et que cette production ne se résume pas à une fable horrifique gothique, uniquement destinée aux frissons.
Mais un film de 1931, c’est un peu vieux non ?
Revoir « Frankenstein » au XXIe siècle est une expérience de Cinéma, mais aussi une expérience historique. Il est important de replacer le film dans son contexte, pour en comprendre toute la portée, et pourquoi est-ce qu’il est entré à ce point dans l’inconscience populaire. De toutes les adaptations de Frankenstein qu’il y a eu depuis, elle est la seule à avoir autant laissé son empreinte visuelle. Le monstre, incarné par Boris Karloff, a posé les bases esthétiques de la créature, qui sera reprise et parodiée un nombre incalculable de fois, des dessins animés aux boites de céréales. La séquence de la résurrection est en cela analogue, puisque son héritage se voit encore de nos jours, avec cette convention (aujourd’hui davantage un cliché) du savant fou et de son assistant difforme.

Maintenant, d’un point de vue purement cinématographique, « Frankenstein » correspond à une petite capsule temporelle, à l’origine de tout un pan du cinéma horrifique. La scène d’introduction reste en cela légendaire, avec le Dr et son assistant qui déterre un cadavre. Si l’on ne voit rien, l’imagerie gothique demeure suffisent puissante pour créer le frisson. Alors oui, aujourd’hui le rythme et le noir et blanc font dater. Pourtant, le film n’a rien perdu de sa puissance évocatrice, et demeure un petit joyau de l’Horreur que tout amateurisme se doit de voir au moins une fois. Et d’une production née dans une pure logique commerciale, réside un véritable chef-d’œuvre du Septième art. Il démontre, encore aujourd’hui, à quel point l’Horreur s’avère un genre sérieux, et même plus, l’un des genres les plus proéminents du Cinéma, tout court.
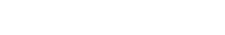








Laisser un commentaire