Alain Robak, France, 1990, 88 min
« Baby Blood » est un film français (et c’est déjà une prouesse en soi) d’Alain Robak, sorti en 1990, à la fin d’une période dorée pour le cinéma d’Horreur. Si à une époque la production hexagonale était en avance dans la manière de raconter ses histoires (merci la Nouvelle Vague), force est de constater qu’avec les années 1980 le retard s’est accumulé en rapport à Hollywood. Les films d’Horreur en France demeurent alors assez rares, et s’il y a eu des expérimentations dans le genre durant les eighties, très peu ont marqué les esprits. C’est pourquoi ce « Baby Blood », encore aujourd’hui, fait figure de précurseur.

Avec les années 1990, le cinéma français va se débrider un petit peu, en proposant des œuvres éclectiques, fantastiques (Jeunet & Caro), violentes (Jan Kounen), extrêmes (Gaspar Noé) et corrosives (Albert Dupontel). Pourtant, même si ces tentatives rencontrent un succès populaire et parfois critique, elles ne peuvent rivaliser et restent très confidentielles. D’ailleurs, la plupart de ces cinéastes s’adoucissent à l’orée des années 2000, à l’exception de Noé et dans une moindre mesure Dupontel. Mais avec la Nouvelle Extrémité Française des années 2000, il est important de constater que le cinéma français horrifique avait du potentiel. S’il est exploré au début du millénaire, « Baby Blood » se présente comme la copie carbone de ce mouvement.
De l’Horreur puisée dans les abysses du temps
Le film d’Alain Robak débute par un monologue étrange, qui donne une dimension lovecraftienne à son histoire, avec des bases audacieuses, laissant entrevoir une ambition courageuse. À l’instar du « Maléfique » d’Éric Valette douze ans plus tard. En utilisant la création de l’humanité pour identifier sa créature, c’est ensuite par le biais du passé colonial de la France qu’il installe l’idée d’un folklore millénaire. Bien plus ancré dans une fantaisie archaïque, il prend pour cadre l’Afrique, sans définir de localisation, juste pour profiter de l’imaginaire inconscient qui s’en dégage. Puis c’est le retour en Europe, dans le Nord de la France, dans un cirque, où l’on rencontre Lyanka, une femme maltraitée et abusée par un compagnon violent.

Le cheminement pour poser le cadre de l’intrigue, qui donne lieu ensuite à un film d’Horreur plus conventionnel, permet d’ancrer le récit dans un contexte qui dépasse les limites du quotidien, pour mieux égratigner ce dernier. Ce procédé s’avère d’ailleurs similaire à celui utilisé par Peter Jackson dans « Braindead » en 1992. Lyanka, la jeune femme du cirque se retrouve alors mise enceinte par un parasite, qui communique avec elle par la pensée, et qui pour grandir a besoin de se nourrir de sang. Débute dès lors un jeu de massacre, accompagné par la dualité à laquelle doit faire face Lyanka. C’est ce rapport entre elle et l’entité qui compose toute la force d’un métrage bien plus riche qu’il n’y paraît.
On ne nait pas Femme, on le devient
En effet, sous ses allures de film d’horreur gore bourrin (ce qu’il est et c’est jouissif), il existe plein de détails qui viennent évoquer la condition féminine. Le parcours de Lyanka n’est pas juste celui d’une personne parasitée par un truc démoniaque. C’est surtout l’itinéraire d’une jeune femme qui essaye de s’émanciper de sa condition sociale, et même de la condition liée à son genre, tout court. Le biais le plus révélateur de cette orientation du récit réside dans le fait qu’elle ne tue par exemple que des hommes. Ces derniers sont représentés par une vaste galerie, qui permet de montrer absolument tous leurs travers. C’est bien simple, dans ce film, il n’y a pas un seul homme décrit positivement, ce sont tous de bien piètres êtres humains.

Alors bien sûr cela ne justifie pas qu’ils soient tués pour autant, mais puisque c’est un film gore, c’en est tout de même d’autant plus jouissif. Entre le directeur du cirque, violent et jaloux et un pauvre type qu’elle rencontre (introduit en train de manipuler une de ses petites amies pour avoir de la thune), autant dire que le portrait n’est pas flatteur. Il est d’ailleurs amusant de retrouver dans le film une apparition de Jean-Yves Lafesse, qui interprète un chauffeur routier homophobe et libidineux, ou bien encore Alain Chabat en dragouilleur des bas-fonds. « Baby Blood » ne se montre pas tendre avec la gente masculine, et si à l’époque c’était peut-être marginal comme sujet (on connaît le mode de fonctionnement du Cinéma français), avec le prisme des années 2020, c’en est que plus pertinent.

Ce n’est pas juste une œuvre qu’il est possible de classer dans une certaine mouvance féministe. C’est un film conscient de l’air du temps et de son époque, et en taclant la misogynie systémique, c’est l’hypocrisie inhérente à la place de la femme dans la société, qu’il dégomme. Tout comme le traitement fait autour du corps de la femme, qui est ici victime de ses caractéristiques pour servir d’hôte. Cette démarche se retrouve, encore dans les années 2020, dans les discours politiques de l’extrême droite, avec la Femme qui est avant tout une machine à procréer. La métaphore autour du viol, présente dans « Baby Blood » ne coïncide pas juste avec un phénomène de la société vieux de trente ans, c’est bien plus ancré que cela. Cela amène le film à traiter en sous-texte la question de l’avortement, et de la complexité d’un tel sujet. L’Horreur au cinéma, ce n’est pas juste des effets sanglants, c’est aussi le reflet insoutenable d’une certaine réalité.
Un cinéma horrifique d’exploitation et de qualité, en France. Oui.
Comme toute bonne série B horrifique qui se respecte, le film d’Alain Robak ne cherche pas juste à choquer par son visuel, mais aussi par son propos. Il n’y a pas de limites dans ce film, qui peut partir dans tous les sens, et part dans tous les sens, sans restrictions. C’est avec une vraie énergie nihiliste et l’amour d’un cinéma parfois cheap, que l’audience peut se laisser embarquer, en toute confiance. Il faut quand même être prévenu, car le film ne se destine pas à tous les publics. La volonté affichée consiste à frapper là où ça fait mal, et de réunir le fond comme la forme, pour mettre en scène une œuvre extrême, consciente des enjeux d’une société en pleine déréliction. Ne pas oublier qu’en 1990, c’était déjà la crise, suite au krach de 1987… Oui, l’Histoire tourne en rond.

Avec sa mise en scène nerveuse, parfois foutraque, et ses effets gores efficaces et splendides, « Baby Blood » en doit aussi beaucoup à Emmanuelle Escourrou qui livre une prestation absolument incroyable. Elle délivre une gamme d’émotion particulièrement riche, qui va de la jeune femme en détresse à la prédatrice la plus impitoyable. Le personnage évolue à mesure que le récit s’assombrit, pour terminer dans une apothéose que l’auteur de ces lignes se gardera bien de dévoiler. Le final mérite amplement le détour, et ne laissera personne sur sa faim. C’est peut-être un peu vieux aujourd’hui, mais c’est un témoignage formidable sur le fait qu’un jour, en France, il y a eu un cinéma gore à contretemps et de grande qualité. Avant la vague des années 2000, plus conventionnelle et dans l’air du temps.
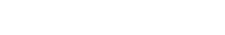








Laisser un commentaire