Kathryn Bigelow, U.S.A, 1987, 94 minutes
« Near Dark » est la seconde réalisation de Kathryn Bigelow, diffusée six ans après son premier essai (en duo) « The Loveless ». Elle y développe ici sa thématique favorite, à savoir le traitement des Étatsuniens de la marge. Que ce soit le paysan du Middle West ou le gang de routards, les personnages de ce film n’appartiennent pas à la « norme ». Pour les vagabonds, cela va encore plus loin, car ils ne répondent même pas aux mêmes règles, vivent la nuit et dorment le jour, ce qui s’avère normal pour des vampires.

Si dans le film ce mot n’est jamais prononcé, il respecte une codification particulièrement fidèle au mythe établi, remontant au-delà de l’Antiquité et présent dans de nombreuses mythologies. Mais le vampire tel qu’on le connaît aujourd’hui est principalement défini par le « Dracula » de Bram Stoker en 1897. C’est ensuite bien entendu les productions gothiques de la Universal des années 1930 et celles plus baroques de la Hammer, dans les années 1960 et 1970, qui ont rendu le mythe des suceurs de sang encore plus populaire. Kathryn Bigelow, qui co-signe le scénario avec Eric Reid, est une cinéphile qui connaît le genre du film de vampire sur le bout des doigts. C’est peut-être même pour cela que le terme n’est jamais mentionné et que rien n’est totalement explicité.
Une œuvre novatrice dans un univers sur-codifié
Film d’horreur made in eighties, « Near Dark » constitue un pur produit de genre populaire, sanglant, bourrin, avec ses gunfights, ses explosions et ses bastons. En somme, il correspond à tout ce que l’ont peut attendre d’un actionner de la période. Mais il possède ce côté horrifique qui lui donne un petit plus, car il se présente comme une œuvre hybride dans une production qui en 1987 reste tout de même relativement peu encline à l’originalité. C’est d’ailleurs ce qui rend ce film inoubliable et le différencie de ce qui a pu sortir à la même époque. Même le titre français, « Aux Frontières de l’Aube », est génial, il faut l’avouer, et donne une aura supplémentaire à l’ensemble.

Une fois de plus, l’histoire se montre classique, puisqu’elle suit un jeune beauf, disons-le, Caleb (Adrian Pasdar), un campagnard un peu cow-boy et incel sur les bords, qui drague lourdement une jolie fille. Si cette dernière ne s’avère pas totalement réticente, elle lui apprend néanmoins les règles du consentement. Mais il existe un problème, c’est qu’elle est une vampire. Et ça ne s’arrête pas là, dans la mesure où May (Jenny Wright) est membre d’une sorte de gang qui arpente les routes de l’Amérique à la recherche de proies pour se sustenter. Mordu, Caleb doit apprendre à tuer pour se nourrir, et c’est à peu près tout ce qu’il faut savoir.
La Famille Américaine : la convention daté d’un conservatisme dépassé
C’est en effet tout le contexte et l’atmosphère du métrage qui prévaut sur une histoire prétexte, comme bien souvent. Par le biais du Road Trip, Kathryn Bigelow nous sert le portrait d’une Amérique cradingue et poussiéreuse, avec son soleil aride et ses nuits crasses. Ce qui occupe particulièrement l’attention du récit, ce sont les outcasts qui composent la horde de vampires. Une sorte de famille dysfonctionnelle, avec le patriarche plein de « sagesse », la mère qui couve ses « enfants », un fils aîné avec un bon gros pète au casque, une fille en quête de liberté et un adolescent esseulé. Ce n’est pas une vraie famille, mais toute la conception de leur gang fonctionne comme telle. Caleb devient alors l’élément extérieur qui va révéler les dysfonctionnements et faire tout exploser, de l’intérieur.

May, qui occupe le rôle de la fille, n’est pas sans rappeler Telena dans « The Loveless », dans un registre toutefois moins tragique. Elle est la jeune femme que la société ne cesse d’entraver et qui ne trouve pas vraiment sa place. Même au sein de sa famille d’adoption elle est la seule à ne pas se satisfaire totalement de leur mode de vie. Elle se révèle également comme celle qui a conservé le plus de son humanité et devient en quelque sorte indispensable à la survie de Caleb, qui saura lui rendre ses sacrifices. Le personnage intéresse par son évolution dans le récit, et témoigne de l’implication de Kathryn Bigelow pour la cause féminine.
Le constat d’une Amérique toujours divisée
Le leader du groupe est donc par tradition un vieil homme, il officie comme père, et demeure le plus âgée, puisque c’est un ancien combattant de la Guerre Civile Américaine (1860 – 1865). Interprété par le toujours parfait Lance Henriksen, lorsque Caleb lui demande quel âge il a, il répond :
« Let say I fought for the South… We lost… »
Cette citation laisse peu de mystère sur ses origines et sur sa conception du monde. À l’instar de ce que l’Histoire a retenu des Confédérés sudistes, il se présente en rébellion envers l’ordre établi, comme le Sud face à un Nord trop moderne à son goût (en gros). De plus, ce personnage se nomme Jesse, une référence supplémentaire à la Confédération, et plus généralement à l’idée romantique du hors-la-loi. C’est en effet le même prénom qu’un certain Jesse James (1847 — 1882), devenu un symbole, dès son vivant.

Tout dans « Near Dark » offre un rapport ambivalent à l’image d’une Amérique glorifiée, pour mieux en montrer les problèmes. En effet, si « The Loveless » présentait un début de la décennie 1980 par le prisme des fifties, Ronald Reagan était à peine élu président. En 1987, lorsque « Near Dark » sort sur les écrans, le pays est lessivé, les inégalités se sont creusées, avec de plus en plus de pauvres à mesure que les riches le devenaient de plus en plus. Si la nation se casse la gueule dans la réalité, à la TV et au cinéma, c’est un mythe triomphant qui est relayé. La preuve en est avec les films ultra-burnés de la période portés par des icônes musclées, comme Schwarzy et Sylvester Stallone, chantres du capitalisme bulldozer.
Qui est vraiment l’ennemi dans un monde immoral ?
Ainsi, à l’image d’un pays s’appauvrissant, il devient difficile de juger frontalement les membres du clan de vampires. Ce sont des rebelles qui ne cherchent qu’à survivre dans un monde où tout est un danger, et la connaissance même de leur existence signifie une mort quasi certaine. De fait, ils se sont accommodés de conditions de vie extrêmes. Selon le point de vue dicté par nos sociétés occidentales modernes, ce sont des méchants, mais dans leur quotidien, ils n’ont trouvé là qu’une manière de survivre et de s’adapter.

L’approche même avec laquelle Kathryn Bigelow met en scène ses vampires montre qu’elle partage une certaine tendresse pour eux. Par ce prisme, c’est Caleb qui semble agir à côté de ses pompes. Il fait le choix du confort, celui d’une petite vie sûre et tranquille, quitte à se plier aux attentes d’une société. Pourtant, il n’y est pas spécialement heureux (comme il est présenté aux spectateurices dans les premières minutes du métrage). Mais à la différence de la troupe de noctambules, lui reçoit une « chance » qu’eux n’ont pas pu avoir.
Un bon petit taquet contre l’Amérique reaganienne
Vis-à-vis de 1987, la présence d’un Confédéré et d’un Texan à la « cow-boy attitude » rappelle ce vieux fantasme de l’Amérique d’antan, idéalisée au possible par les idéologues de la droite conservatrice alors au pouvoir. L’importance de la famille, la vraie, prévaut coûte que coûte, celle avec laquelle on peut se mettre en désaccord, mais avec qui il faut rester en bons termes. Cette défense d’un idéal communautaire (très puissant aux États-Unis) passe par l’appartenance à une communauté bien établie et respectée, véritable marque d’intégration interpersonnelle.

Cela se fait au détriment de la différence et du rejet de tout ce qui n’entre pas dans les normes, et s’apparente par défaut à de l’inadaptation sociale. Résultat, « Near Dark » livre le portrait à deux vitesses et extrêmement nuancé de l’Amérique sous Reagan. Investis par de belles paroles et un attachement hypocrite aux valeurs fondamentales d’une nation née sur un ethnocide (oui), les conservateurs ratent fondamentalement le coche de ce que doit vraiment être une grande famille. En l’occurrence ici, le mythe de la Famille Américaine se retrouve le total opposé d’un milieu inclusif, ouvert d’esprit, totalement aveugle aux différences, acceptant en son sein même ceux qui apparaissent hors de la « norme ».
Un constat corrosif par le biais d’un divertissement jouissif
Par son traitement réaliste et rude, Kahryn Bigelow livre une œuvre de Cinéma qui ne prend pas une ride, puisque son propos demeure aujourd’hui des plus actuels. La lente déliquescence des sociétés capitalistes trouve ses racines dans les années 1980 (il est même possible de remonter à l’ère Eisenhower en ce qui concerne les U.S.A). Aujourd’hui, ce sont les échos de cette crise civilisationnelle qui résonnent dans tout l’occident, et un peu au-delà. Bigelow n’est pas une visionnaire ni une devineresse, c’est une modeste cinéaste qui parle un langage cinématographique universel et populaire. Par le biais du genre, elle constate avec intensité son époque, et possède le don de la mettre en image, sans hypocrisie, sans fard et sans fioritures. Certainement l’un des plus grands films d’Horreur jamais réalisés, ce n’est pourtant « que » une série B avec des vampires. Parfois il ne faut pas plus que cela.

Rien à voir, mais il est à noter que le casting, en plus d’être génial, se compose d’une partie de celui du « Aliens » de James Cameron (1986), en les personnes de Lance Henriksen, Jennette Goldstein et le regretté Bill Paxton (1955 – 2017), qui livrent ici des prestations parfaites. Et pour le clin d’œil, il est aussi possible d’y voir Troy Evans en flic, qui évoque tout le mépris que possède Kathryn Bigelow envers les forces de l’ordre, mais cela, c’est une autre histoire.
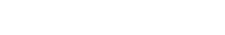








Laisser un commentaire