Dusty Cundieff, U.S.A, 1995, 97 min
Avec la popularité et la multiplication des In Da Hood Movie, à la charnière des 80’s/90’s, la lumière était mise sur les conditions de vie difficiles d’une grande partie de la communauté afro-américaine. Hollywood servait alors d’écho à la misère sociale et la mise au ban de la société de toute une part de la population, avec pour raison principale leur couleur de peau. Cela était certes au siècle dernier, il y a trente ans…
Mais l’histoire des Noirs américains à Hollywood ne commençait pas là. Dans les années 1910, cette communauté, encore reléguée à une citoyenneté de seconde zone, apparaissait à l’écran sous la forme d’acteurs blancs peints en noir : l’infâmeuse blackface. Cette manière de faire perdure jusque dans les années 1930, décennie où les comédienes afros’ parviennent à se créer petit à petit une place au sein de l’industrie du cinéma. En 1940, Hattie McDaniels sera la première personne noire à recevoir un Oscar, pour un second rôle dans « Gone With the Wind ». Le second, James Baskett, recevra lui un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 1948. Le troisième sera Sidney Poitier en 1964, et le quatrième est Louis Gossett Jr. en 1982…

Changer les mœurs est long et fastidieux, comme nous l’ont montré les mouvements #metoo en 2017 et bien sûr Black Live Matters en 2013. Mais ça avance, ça évolue, petit à petit, généralement dans la souffrance. La mode [faussement progressiste] de la blaxploitation mise à part, la place des Afro-Américains gagne surtout du terrain à Hollywood lors des années 1980, en particulier dans le genre de l’Horreur. Une inclinaison qui fera d’ailleurs naître l’un des clichés encore moqués aujourd’hui : si vous êtes noirs dans un film d’horreur, vous êtes potentiellement la première personne à mourir.
Du film horrifique à porté sociale
En 1995, alors que la mode des In Da Hood movies atteint son pic, un petit métrage horrifique vient tordre le cou à cette tradition. Dusty Cundieff et le scénariste Darin Scott s’inspirent du « Creepshow » de George A. Romero, de l’ambiance pulp de la série « Tales From the Crypt » et des productions d’épouvantes à sketchs en général. Cela leur permet de proposer une œuvre terriblement fun et drôle, « Tales From the Hood », qui se montre aussi particulièrement terrifiante, car elle n’oublie jamais de constituer un vrai film d’horreur.

Ultra-politique et chargé d’une critique sociale au vitriol, le métrage offre un témoignage inestimable sur la vie quotidienne des Noirs dans les quartiers populaires (ghetto) des grandes métropoles américaines. Des lieux où cette communauté se retrouve majoritairement parquée, sujette à une importante pauvreté et confrontée à une violence permanente, institutionnelle, politique, policière et autre. Mais aussi celle inhérente à l’indigence : brutalité conjugale, molestation d’enfant, meurtres entre gangs et leurs victimes collatérales. Une chose demeure certaine, « Tales from the Hood » constitue une œuvre riche et lourde de sens.
Le film à sketch, ce joyeux scénaristique
Tout commence lorsque trois jeunes hommes, dont l’un semble clairement affilié au gang des Crisps (dont il affiche les couleurs) se rendent chez un type étrange pour acquérir « the Shit ». Mais, le type étrange en question ignore de quoi ils parlent, lui qui n’est que le gérant d’une maison mortuaire. Il prend dès lors le temps, face à l’attitude vindicative des trois jeunes, de leur raconter quatre « cautionary tales » qui se sont déroulée dans le quartier. Le film enchaîne alors quatre histoires bien distinctes, avec pour fil conducteur les trois gars chez le croque-mort.

D’une richesse inouïe, ces courts ne sont pas dénués, au départ, d’un certain humour et d’un second degré des plus bienvenus, qui traite de sujets pourtant dramatiques. Mais en avançant, le récit se montre de plus en plus sombre, et l’ultime sketch mettra plus d’un spectateurices mal à l’aise, par un recours à l’horreur pure, pas spécialement visuelle, mais particulièrement psychologique. Tour à tour, les histoires abordent ainsi chacune une problématique, qui frappe de plein fouet la communauté afro-américaine des nineties.
La réalité horrifique d’une communauté
Pour un Afro-Américain, le Boogeyman ne porte pas de masque, il ne tue pas au couteau, à la machette ou à la hache, il n’hante pas non plus les rêves de ses victimes. Non, le Boogeyman pour un Afro-Américain il a une casquette, un uniforme bleu, un badge, un flingue et il rôde de nuit comme de jour dans les quartiers. L’une des histoires se penche ainsi sur les violences policières. Trois ans après l’affaire Rodney King, cette vidéo montrant des policiers (blancs) frapper au sol un automobiliste (noir), l’écho de la séquence rebute autant qu’elle révolte. Mais le plus terrifiant vient du fait que le film date de 1995. Vingt-cinq ans dans le futur, une scène quasi-similaire s’est également produite devant des caméras, de téléphones cette fois, lors de l’arrestation de George Floyd, qui lui coûtera la vie le 25 mai 2020.

Tout le film agit comme ça, mettant en lumière l’état d’une violence généralisée, à l’instar de ce segment qui vise l’hypocrisie politique et le nouveau visage des suprématistes blancs affiliés au Ku Klux Klan. Ceux-là mêmes qui manifestaient le 12 août 2017 à Charlottesville, où une jeune afro-américaine de 32 ans, Heather D. Heyer, fut tuée sous les roues de la voiture bélier d’un néo-nazi fonçant dans la foule. Parmi les suprématistes en présence se trouvait David Duke, figure médiatique du KKK depuis les années 1980, que moque avec allégresse un segment de « Tales From the Hood ». En effet, un personnage se nomme Duke Metger, combinaison de David Duke et Tom Metger, fondateur de la white aryan resistance. Tout un programme.

Ce segment se révèle plutôt fun, car il moque avec finesse une partie des politiciens suprématistes qui gangrènent les sphères institutionnelles. À commencer par Donald Trump, qui vingt-deux ans après cette production soutint du bout des lèvres les partisans du « white power » présents à Charlottesville. Ce qui rend amusante cette histoire, c’est que Rusty Cundieff et Darin Scoot n’oublient jamais qu’ils proposent un film d’horreur, et ils la mettent en scène en conséquence. Ils utilisent ici des marionnettes tueuses, qui offrent une ambiance particulièrement réussie, magnifiée par le savoir-faire des mythiques Frères Chiodo (à l’origine de « Killer Klowns From Outer Space », l’horror flick le plus funky des années 80). Mêlant l’héritage esclavagiste, Ku Klux Klan, hypocrisie politique et vaudou, ce passage tourne en dérision un sujet brûlant et peu évident à aborder. Seul le genre de l’horreur semble permettre de remettre tout le problème en perspective à la perfection, pour mieux le dégommer à vue.
Une communauté déchirée aussi de l’intérieur
L’un des récits proposés par les deux compères traite également de lourdes thématiques, comme l’abus sexuel sur un enfant et les violences physiques au sein du foyer, par un membre de la famille. Bien que fort d’un final délirant et bienvenu, l’ambiance distillée s’avère particulièrement sombre, beaucoup plus malsaine et pesante. Interprété par David Alan Grier, habitué aux rôles plutôt comiques, l’abuseur absolument terrifiant n’est pas sans rappeler la performance de Terry O’Quinn dans « The Stepfather » de Joseph Ruben. Sujet peu évident, c’est par l’entremise d’une grande finesse, une intelligence d’écriture qui force le respect et la présence de protagonistes très humains, que jamais le récit ne sombre dans une certaine complaisance. Toujours très juste, à l’image de l’ensemble, ce segment illustre parfaitement le travail de funambule accompli par Cundieff et Scott.

Une ultime histoire vient aborder frontalement la tragédie engendrée par les gangs et le gâchis que cela génère. L’un des principaux fléaux de ces ghettos demeure en effet la violence des Afros commise envers les Afros. Elle se traduit par de véritables guerres entre gangs, où nul ne se trouve à l’abri de se prendre une balle perdue. Sujet particulièrement sensible, encore en 1995, il est ici mis en scène avec une grande qualité d’écriture, car c’est certainement le segment le plus horrifique d’entre tous. Il se montre absolument terrifiant, puisqu’à aucun moment « Tale From the Hood » ne perd de vu que c’est bien un film d’horreur et non un drame moral ou un mélodrame à propos.
Un œuvre dans la continuité d’un Cinéma engagé
L’influence de George A. Romero peut une fois de plus se ressentir dans la dimension éminemment politique de l’ensemble. Sous son enrobage horrifique, qui n’hésite aucunement à s’orienter parfois vers un comique des plus bienvenus, cette œuvre s’avère particulièrement réflexive. Elle possède la marque des grandes productions cinématographiques, puisque vingt-cinq ans après sa sortie elle demeure toujours d’actualité.

Rarement citée parmi les œuvres cultes de l’horreur à l’Américaine, elle mérite pourtant amplement une réévaluation. Cette dernière semble déjà avoir débuté puisqu’entre 2018 et 2020 le film eut le droit à deux suites, avec le même duo aux manettes. Au cœur d’une décennie marquée par d’importants changements, « Tales From the Hood » témoigne avec efficience du quotidien difficile d’une communauté encore mise à l’écart. Trente ans après avoir obtenu les droits civiques et vingt ans après avoir fourni le plus de chair à canon pour défendre les valeurs américaines au Vietnam… Et comme le temps le montre, tout est encore loin d’être réglé.
Un objet témoin des évolutions d’une nation
Ironiquement, la première victime de « Tales From the Hood » est un Noir (il revient d’entre les morts pour débuter le jeu de massacre du métrage), mais derrière et devant la caméra œuvrent des Afro-Américains. Sans surprise, cette œuvre vaut amplement toutes les autres du genre. De plus, le film marque à sa manière l’histoire de ce petit cinéma d’horreur (le budget atteint tout juste 6 millions de dollars). En effet, l’année suivante le terriblement sympathique « Tales From the Crypt : Demon Knight » d’Ernest Dickerson proposera en protagoniste une jeune Afro-Américaine, interprétée par Jada Pinket. Puis en 1999 Will Smith devenait le premier acteur afro-américain à occuper le premier rôle d’un Blockbuster à 170 millions de dollars, le débilement fun et over-the-edge « Wild Wild West » de Barry Sonnenfeld. (Sur « Independance Day », il partage le top des crédits avec Bill Pullman et Jeff Goldblum et dans « Men in Black » Tommy Lee Jones reste crédité en premier)

« Tales From the Hood » se positionne ainsi parfaitement dans la vague des In Da Hood Movies, mais le genre auquel il répond avant tout correspond totalement à celui de l’horreur. Il instituait là une nouvelle opportunité pour des scénaristes et cinéastes afro-américains, qui perdure encore aujourd’hui. Comme l’atteste les excellents « Get Out », « Us » et « Nope » de Jordan Peele, qui dépassent amplement le clivage d’une bien désuète couleur de peau, bien heureusement.
Et Black Live Matters, car c’est certainement là l’important.
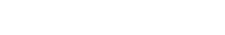








Laisser un commentaire