Rusty Candieff & Darin Scott, U.S.A, 2020, 102 min
Changement d’ambiance radical pour ce « Tales From the Hood 3», et exit Mr Simms et son « The Shit ». Le métrage prend une orientation très différente, beaucoup plus recentrée sur l’aspect horrifique. Sans délaisser la nature sociale de l’ensemble, il se montre beaucoup plus incisif, ainsi que plus fin, en quelque sorte.

La conteuse est ici Brooklyn, une fillette de six ans, qui partage des histoires à l’homme qui l’aide à retrouver sa mère. Perdus dans des bois, où règnent une atmosphère très lourde et une urgence, les deux personnages fuient une présence qui les poursuit. Pour se rassurer, Brooklyn se remémore des récits que sa mère lui a racontés, des contes moraux agrémentés d’une bonne dose d’horreur. Venant d’une jeune fille, cela apporte une inclinaison nouvelle. Le personnage se révèle beaucoup moins inquiétant qu’un Mr Simms ou du Cryptkeeper de « Tales From the Crypt ».
La societé occidentale, ce gros bazar
En quatre segments, Rusty Cundieff et Darin Scott, toujours co-co-réalisateurs et scénaristes, poursuivent leurs réflexions sur les conditions de la communauté afro-américaine, à l’ère de la présidence Trump. Avec maîtrise et pertinence, plus timoré dans l’opus précédent, c’est sur une note bien plus sombre que se joue le métrage. Il y règne pourtant un humour noir permanent, qui contribue à rendre cet épisode plus proche du petit chef-d’œuvre de 1995.

Les différentes thématiques demeurent particulièrement riches, et brassent un peu tout ce qui participe à faire de nos sociétés un gros bordel orchestré par une hypocrisie ambiante. Dans un monde où l’indigence est systématiquement pointée du doigt, quand le système écrase les plus démunis dans une spirale morbide où les privilégiés s’avèrent sans cesse avantagés, il devient difficile de conserver de l’optimisme. Ce fait, Cundieff et Scott l’ont parfaitement compris, puisque les histoires qu’ils proposent concernent davantage la pauvreté systémique. Aux États-Unis, elle touche une grande partie de la communauté afro, mais dépasse largement la barrière de l’origine ethnique. En somme, tout le monde coule à bord du même bateau.
C’est toujours de la faute du capitalisme, cherchez pas !
En ce sens, le premier segment présente un jeune agent immobilier carnassier, que ne guident que la réussite, l’argent, une place dans la haute et un reniement total de ce qu’il est. Sous la pression d’un boss classique (comprendre un vieux mâle blanc, comme il en existe un peu trop aux postes décisionnaires), il méprise totalement une famille dans le besoin. Il menace d’expulsion un modeste foyer, malgré la maladie qui ronge leur jeune fils. Le propos explicite la manière avec laquelle, pour un peu de thune et de reconnaissance de la classe dominante, un homme peut se renier au point d’abandonner son humanité, à des fins purement pécuniaires.

Pointant ici sauvagement du doigt l’œcuménisme capitaliste qui gangrène la vie des peuples occidentaux, Cundieff et Scott n’y vont pas de main morte. La parabole horrifique leur permet, en tout excès, de faire chèrement payer sa trahison à un homme qui s’est voulu autre, en écrasant ses semblables. Si l’agent et la famille sont des Afro-Américains, et que le propos rend écho à cette communauté, le principal biais employé reste la pauvreté. Ce à quoi elle peut mener, soit un chemin balisé par une société schizophrène, ou bien vers un altruisme qui fait passer l’être avant toute chose. Ici, c’est cette famille qui choisit la pauvreté comme forme de vie, pour consacrer tout à un enfant malade. Deux poids, deux mesures.
Une construction narrative aboutie
Dans un formidable jeu de connexion, la troisième histoire reprend en filigrane les mêmes thématiques, pour les transposer dans la soif de reconnaissance. Devenir une star, être adulé de ses pairs, de ses proches ou d’inconnus, même si pour cela il n’y a rien à proposer et que pour arriver à ses fins il faut tricher ou écraser les autres. En suivant l’éclosion d’une chanteuse de R’n’B, le récit reprend en filigrane le mythe de Faust, dans une version amusante, même si très sombre, du « Phantom of the Paradise » de Brian de Palma en 1974. Par une originalité salvatrice, ce segment entraîne son audience vers une chute aux enfers, celle d’une personne qui ne demandait pourtant rien de mieux que de vivre de sa passion, pour s’extirper de sa condition sociale. Mais le succès apportant son lot de complication, rapidement la jeune femme perd pied…

Par un jeu d’écho, Rusty Cundieff et Darin Scott permettent à « Tales From the Hood 3 » de faire preuve d’une cohérence solide dans son propos. Cela manquait justement au second volet. Les histoires construisent une structure solidement reliée aux séquences avec Brooklyn comme axe principal. D’imagination et de messages, les deux cinéastes n’en manquent pas et ne sombrent pas dans une complaisance répétitive qu’annonçait le précédent film, qui de fait apparaît vraiment en deçà. Rien que l’inquiétant William, incarné par le cultissime Tony Todd, apporte une nouveauté, puisque le récit se retrouve désormais mené par une petite fille, quand le vieil homme se montre un petit peu à la ramasse.
Une critique toujours aussi virulente
Sans livrer davantage d’éléments, afin de ne pas gâcher le plaisir et la surprise de découvrir l’ensemble du métrage, les deux autres segments, très différents, assurent à la fois le cachet pamphlétaire et la garantie horrifique. Ces deux concepts se marient admirablement bien, et offrent une texture au contenu, qui ne peut laisser indifférent. « Tales From the Hood 3 » propose ainsi l’un des états des lieux des plus virulents, concernant la période Trump, vue dans un film. Au premier abord, ce segment semble manquer de délicatesse, ce qui en un sens est vrai. Cependant, il « defonce » (je ne vois pas d’autre terme…), à bride abattue et avec une acidité vitriolée, Trump et ses supporters, qui ne font pas non plus tellement preuve de finesse…

(faite attention au petit drapeau dans le dos)
Le principe même cherche à mettre de côté tout procédé attentiste, pour embrasser les codes d’une politique virulente, xénophobe et anxiogène. Ainsi, cette orientation ne peut que satisfaire une audience blasée, qui ne demande rien d’autre que de voir un juste retour des choses. Par une dimension dystopique, mais pas tant que ça, le propos se décuple pour mieux multiplier les ressentis. Du rire à l’effroi et de l’énervement au dépitage, il fait surtout froid dans le dos par son réalisme contemporain, celui d’un conte que nous avons tous vu en regardant les informations ces cinq dernières années. Le récite se situe plus ou moins dans les relents du XXe siècle, orienté sur l’autodestruction programmée d’un occident autocentré, dont le but ultime que de détruire l’humanité, au nom du sacro-saint dollar.
Un quatrième segment ainsi qu’une conclusion inattendue pour le fil rouge achèvent de constituer une œuvre à l’intelligence rare, ponctuée d’un humour à deux balles, des plus réjouissants. À ce point clairvoyant sur une société en déclin de partout, il est compliqué de trouver, à l’heure actuelle des équivalents. Immédiatement revient en tête le « Get Out » de Jordan Peele, ou bien la nouvelle adaptation de « Candyman » en 2021, qui démontrent que l’horreur devient progressivement un genre en forme d’écrin réflexif pour la communauté afro-américaine.
L’Horreur Afro-américaine : un sous genre en puissance
Depuis environ six ans, des cinéastes afros commencent (seulement) la longue et fastidieuse écriture de leur histoire, par le septième art. Processus creatifo-historique et culturel, propre aux États-Unis, il permet une liberté d’expression totale, comme le démontre cette trilogie. Bien plus que des petits films d’horreur, les « Tales From the Hood » composent bien des documents inestimables sur une prise de conscience à perpétuer. Celle de toute une communauté, et son ras le bol de souffrance, dont l’objectif s’avère désormais de faire valoir sa légitimité à vivre comme n’importe quel citoyen lambda.

Ces réflexions dépassent de loin un cinéma hollywoodien, qui sans cesse a pu se montrer critique, dès ses débuts dans les années 1910. Comment ne pas citer Oscar Michaux, et ses productions teintées de politique, déjà dans les années 1920. Son but était de replacer les Afro-Américains comme membres à part entière d’une société, pourtant plus encline à les écraser. Le cinéma de George A. Romero apparaît également séminal dans cette réflexion entre horreur et pamphlet sociétal, puisqu’il est le premier à avoir su conjuguer à merveille l’horreur avec la politique. Ce cocktail perdure depuis la fin des années 1960, dans un système de production alternatif, qui s’émancipe des conventions hollywoodiennes, pour se rendre incisif.
Une œuvre engagé et extrêmement consciente
Il est peu étonnant de retrouver comme producteur exécutif de cette trilogie le prolifique Spike Lee, cinéaste qui ne perd jamais une occasion de se positionner sur la condition afro dans le pays de l’Oncle Sam. Où règnent les WASP, bien en peine de laisser un peu de place à de multiples peuplades, qu’ils ont pourtant accueillies au nom de la constitution. Cet artefact, vieux de 240 ans, est de toute façon bafoué par un pouvoir blanc de plus en plus contesté. Comme le démontrent les élections de novembre 2020 et l’invasion du Capitole en janvier 2021, les États-Unis se retrouvent aujourd’hui à un point de rupture. La nation étoilée n’a jamais été autant divisée que depuis la Guerre civile (1860-1865). C’est bien d’une ruine qu’ont hérité Joe Biden et Kamal Harris.

Et quoi de mieux qu’une ruine pour commencer à entrevoir les fondations pourries d’une bâtisse qui ne demande qu’à être assainie et reconstruite ? Avec « Tales From the Hood 3», Rusty Candieff et Darin Scott apportent ainsi leur pierre à un édifice en reconstruction, qui dans les années à venir devrait retrouver son éclat et redevenir ce lieu de liberté et d’asile qu’il aurait toujours dû demeurer.
Pour en Savoir Plus
Tales From the Hood 2 sur IMDB
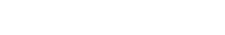







Laisser un commentaire